42 – Retour par les Tuamotu
- Jo et Jo

- 17 mars 2021
- 15 min de lecture
Le mois de mars est arrivé. Nous devons reprendre la route du retour.
Notre projet de nous rendre à Ua Huka, la dernière des 6 îles habitées se heurte aux vents contraires et au temps qui nous est désormais compté pour rentrer à Tahiti pour le milieu du mois de mars.
Nous effectuons une première escale à Ua Pou qui est sur notre route avant la grande traversée jusqu’à Fakarava. Nous avons droit à une arrivée avec une vue très dégagée sur « l’île aux piliers ». Nous passons ainsi une nuit tranquille au mouillage dans la magnifique baie du village de Hakahetau, prêts à repartir pour le lendemain matin.
Nous quittons l’archipel des Marquises, des souvenirs plein les yeux et plein le cœur. On dit que ces îles les plus éloignées de tout continent exercent une attractivité et un charme particuliers et qu’on en repart différent.
C’est tout à fait ce que nous ressentons et même s’il n’y a pas ici les lagons turquoise des atolls, il y a dans les reliefs et surtout dans l’incomparable richesse culturelle et archéologique un aspect d’authenticité qu’on ne retrouve pas facilement ailleurs.
Chaque île, chaque lieu est différent et offre des facettes complémentaires sur le savoir-faire artisanal. Chacune a de plus son propre dialecte dérivé du marquisien, lui-même différent du polynésien.

Il y a peu de touristes, comparé aux autres îles, notamment celles de l’archipel de la Société, qui captent toute la manne touristique et les investissements, laissant la partie congrue aux autres archipels du territoire, ce qui ne contribue pas à leur développement.
On ne peut que tomber amoureux de ce pays préservé, de ces lieux uniques, simples et généreux comme leurs habitants.
On peut ainsi se laisser aller à paraphraser Monsieur Jourdain, ce bourgeois gentilhomme ridicule et pathétique qui faisait de la prose sans le savoir, en proclamant :
« Belles Marquises, vos beaux lieux, d’amour mourir me font »
Nous amis les dauphins nous auront accompagné dans ce périple, venant nous saluer à chaque arrivée et à chaque départ de chaque île.
Savaient-ils que nous les quittions ?
Voulaient-ils à leur manière saluer les deux dauphins à la proue de Jo&Jo, ou de ceux reproduits sur nos tatouages ?
En tout cas, ils étaient présents au rendez-vous, adultes et bébés - ainsi que les oiseaux - pour accompagner notre catamaran pendant près d’une heure, dans une mer d’huile qui nous rendait leur observation encore plus proche et magique.

Vous êtes nombreux à apprécier nos vidéos de dauphins et il est vrai que cet animal exerce un attrait particulier lié à notre enfance, à son côté joueur et à son « sourire » qui nous le rend familier et sympathique.
Partageons une nouvelle fois ce spectacle dont on ne se lasse pas, les yeux émerveillés par leur danse et le fait que ce sont eux qui nous choisissent pour assister à leur parade virevoltante.
Nous ferons à nouveau la traversée entre Ua Pou et Fakarava (550 miles nautiques soit 1020 kilomètres) sans croiser un bateau ou presque. Seul un cargo passera au large de notre route à mi-parcours à l’ouest des îles du désappointement (bien-nommées par les premiers explorateurs car elles sont les premières que l’on trouve en venant des Marquises en direction des Tuamotu mais elles ne possèdent pas de passe et il n’est pas possible d’y accoster ni d’y mouiller).
A la vitesse raisonnable de 5 nœuds de moyenne, nous mettrons 4 jours, 4 nuits et 8 heures pour atteindre notre destination, sans une goutte de pluie.

La dernière journée en approche de Fakarava, le vent tombe et tourne par l’arrière. C’est l’occasion de mettre le parasailor, cette voile de spinaker très particulière, en toile de parachute, qui possède un décrochement à un tiers de la hauteur ressemblant à un parapente.
L’allure est très calme et il n’y a pas grand-chose à faire d’autre que se reposer dans les hamacs tendus entre le mât et le cockpit.
Il faut bien s’occuper durant ce temps suspendu, bercés par un vent et une houle au portant, somme toute assez confortables.

Outre les activités physiologiques des trois repas par jour - ce jour-là, gratin de pomme de terre aux champignons, accompagné de vin blanc Tariquet, suivi d’une compote de mangues - nous nous adonnons à quelques passe-temps.
Il y a la lecture, le visionnage de films, la contemplation de la nature infiniment bleue ou des nuits d’étoiles sans nuages, l’écoute de la musique, les périodes de quart à la barre et les périodes de repos à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

La vie s’écoule ainsi très tranquillement, chacun vivant à son rythme.
Le temps passe finalement très bien au point que les jours succèdent aux jours de manière fluide. Si on ne dort pas la nuit, on se rattrape le jour.
Le capitaine, entre les périodes de navigation et les périodes de repos, s’acquitte de sa tâche journalière du journal de bord sous la forme du blog de Jo&Jo qui arrive sans crier gare au numéro 42.
Sylvie prépare de bons petits plats. Il est facile de cuisiner en naviguant au portant, avec une houle très faible et très longue et le four est mis à contribution pour confectionner du pain, des gâteaux, des lasagnes ou des gratins de légumes.
Le capitaine s’acquitte de sa tâche journalière du journal de bord sous la forme du blog qui arrive sans crier gare au numéro 42.
Un point météo est réalisé toutes les six heures grâce à une connexion satellite. Elle permet l’intégration des fichiers de données dans une application qui détermine la meilleure route à suivre pour profiter des vents, éviter les pluies et les les grains, tenir compte de la houle.
Jessica, entre deux séances de yoga ou de bronzage, prépare des jus de pamplemousse à partir des énormes spécimens rapportés des Marquises. Elle n’hésite pas à mettre la main à la pâte pour confectionner du pain.
Mais, contrairement à Peau d’âne, elle ne laissera pas tomber sa bague en pétrissant la pâte et n’aura pas l’occasion d’attirer ainsi le prince charmant…
Elle ouvrira également un atelier coiffure pour faire une tresse à Sylvie dans le carré arrière.
Sylvie lui rendra la politesse en ouvrant à son tour un atelier « gommage - masque - soins du visage ».

Toutes les parties du bateau sont bien utilisées.
Ce n’est pas très grand et il faut bien varier les lieux, quitte à prendre des postures acrobatiques pour lire Taïpi, le roman autobiographique de Herman Melville au poste de pilotage à l’arrière ou profiter des hamacs.
La mer est si belle et si calme que nous osons même lancer à l’eau une ligne de vie pour nous laisser tirer à près de 4 nœuds derrière le catamaran, en espérant ne pas croiser un requin pèlerin en plein pèlerinage et surtout en ne lâchant pas le précieux filin qui nous rattache au bateau, faute de quoi il faudrait lancer la procédure d’homme à la mer...
Bien que les procédures - ainsi que toutes les consignes de sécurité - aient été expliquées, nous ne tenons pas à faire un exercice en conditions réelles.
Il faut dire que l’eau est à 28 degrés. Elle est très bonne et nous fait le plus grand bien. Mais nous avons tout de même plus de 3000 mètres de profondeur sous nos pieds et la vitesse nous brasse assez fortement…
Le jeu roi sur le Jo&Jo est également à l’honneur avec des parties endiablées de « 6 qui prend », un jeu de cartes à partir de 3 joueurs qui allie chance et stratégie.

Nous revoilà à Fakarava. L’atoll n’est visible que dans les derniers kilomètres. Finies les montagnes majestueuses des Marquises et les îles sans lagons. Nous voici revenus dans l’horizontalité des Tuamotu.
On ne franchit pas la passe du nord dans les meilleures conditions de marée, car le flux est dans sa plus grande intensité entre la pleine mer et la basse mer nous il nous brasse vigoureusement avec un courant contraire et sortant de près de 6 nœuds. Mais il fait jour et il fait beau, nous franchissons le côté de la passe en évitant le fort mascaret du milieu, et puis nous avons déjà franchi cet obstacle à l’aller et nous connaissons les lieux. Moteurs à fond, nous progressons dans le bouillon à la vitesse de 2 nœuds pendant 10 minutes avant de nous retrouver enfin dans le calme du lagon.
Cela fait deux mois que nous n’avons pas connu de surface exempte de vagues. Au mouillage, le silence est assourdissant. Pas de vagues, pas de vent, pas de bruit. L’eau est claire et les plages sont ourlées de sable de corail blanc bordées de cocotiers. Un plongeon au pied de Jo&Jo, une bonne douche et nous voici ressourcés. Nous nous réacclimatons très vite à ce nouvel environnement.
Du coup, quand on y pense, il faut reconnaitre que c’est ouf, et c’est pas faux ! (Florilège des tics verbaux de l’équipage : « du coup » et « c’est ouf » pour Jessica, « quand on y pense » et « il faut reconnaitre » pour Sylvie et « c’est pas faux » pour Jacky).
Petit appoint en eau et en gasoil au quai de Rotoava, le village principal et nous retournons au Fakarava Yacht Services pour récupérer notre voile de génois recousue et faire laver deux machines de linge.
Pour le petit linge, nous avons toujours à bord notre machine écologique fonctionnant à pédale. Le jeudi, Jessica en profitera pour faire sa gym et on immortalisera ainsi la rencontre de G6K et de R2D2 dans « Le retour du jeudi »…
Il fait très beau et nous allons déjeuner au snack « Le requin dormeur » en bord de plage. Il n’y a pas grand monde et nous profitons de la quiétude et de la beauté de l’endroit.
Rien n’est plus agréable que de déjeuner assis dans l’eau limpide et chaude sous une paillotte ombragée avec un panorama de carte postale, avec des petits poissons, pas farouches du tout, venant nager parmi nous..

Nous profitons de l’instant. Il suffit de laisser glisser du banc de pierre où nous sommes assis pour faire trempette au milieu des poissons. Mais nous ne sommes pas les seuls.
Le nom de « requin dormeur » n’a pas été donné par hasard à ce snack de plage de l’hôtel Hawaiki.
Un beau spécimen - un requin dormeur peut mesurer de 2 à 3 mètres à l’âge adulte - vient nous rendre visite et s’installe à quelques centimètres de notre table et de nos pieds. Même pas peur ! On sent que le bestiau n’est pas belliqueux et s’il parait inoffensif, tel un bon gros toutou assis au pied de la table de ses maîtres, on ne se risque pas à aller l’approcher et le caresser pour autant. Mais jugez plutôt…
Sur le chemin du retour, nous sommes interpellés par une vieille dame assise en bord de plage sous un arbre. Elle cherche visiblement le contact et elle a envie de nous parler. Nous restons avec elle plus d’une demi-heure, à écouter sa vie riche digne d’un roman.
Poline - c’est son prénom - est née en 1940. Elle était une jolie vahiné autrefois, danseuse et chanteuse de surcroît et elle avait été repérée par deux français qui l’ont fait tourner dans un film « si Tahiti m’était conté » avant de lui faire connaître la France, en particulier le sud-est. Elle a également dansé au Palais de Chaillot à Paris.
Elle a joué dans le court métrage « Manureva, la fille de Tahiti » de Claude Pinoteau en 1960 et chanté la chanson titre qui est devenue un classique du patrimoine musical polynésien.
Puis s’est mariée à un riche américain, directeur de la compagnie américaine d’aviation PanAm. Elle a vécu longtemps dans le Colorado où vivent encore ses deux enfants et petits-enfants.
Elle n’est pas peu fière de raconter qu’au temps de sa splendeur, elle avait été invitée au restaurant par Neil Armstrong, le premier homme à mettre le pied sur la Lune. On a pu tester son esprit ouvert et son sens de l’humour en lui disant que ce spécialiste des corps célestes voulait sans doute connaitre sa lune à elle.
Après tout, ce n’est qu’un petit pas pour l’homme… et il n’y a que le premier pas qui coûte…

Elle est revenue vivre au fenua et possède, selon ses dires des terrains et de nombreuses fermes perlières héritées de sa mère. Sans chercher à démêler le vrai de l’exagération, nous passons un très bon moment avec cette vénérable dame qui ne fait pas son âge et qui est d’une gentillesse extrême.

Nous reprenons le chemin de la passe sud de Fakarava pour une halte à Irifa, une anse bien abritée des vents d’est et de nord. Nous ne sommes que 4 bateaux et il n’y a rien d'autre qu’un petit snack au bord de la plage de sable rose.
Mais il n'y a personne pour nous accueillir en milieu d’après-midi, si ce n’est un chien, un chat, un petit cochon et des bernard-l’ermite.
Une belle terrasse, quelques hamacs et une slackline tendu entre deux cocotiers sont les seuls aménagements de ce lieu loin de tout.
Nous nous baignons dans une eau transparente où l’on peut facilement observer les raies et les petits requins qui passent près de nous.

Si nous faisons une halte vers la passe sud de Fakarava, c’est pour ce formidable endroit unique au monde où on peut observer le fameux « mur de requins », près de 400 requins gris qui vivent dans le courant de la passe de Tetamanu et que l’on peut facilement observer depuis une profondeur de 15 à 20 mètres.
La taille de ces requins est déjà conséquente puisqu’ils peuvent atteindre 2,50 mètres de longueur à l’âge adulte. L’endroit est aussi connu pour le rassemblement des mérous qui viennent de partout pour frayer spécialement à cet endroit la nuit de pleine lune du solstice de juillet, ce qui produit une rencontre infernale entre ces deux espèces, observée en 2015 ans par le plongeur Laurent Balesta qui est resté 24 heures en plongée à 10 mètres de profondeur et en a tiré un film documentaire époustouflant : le mystère mérou.
Il y a une vie grouillante dans ces eaux et les poissons sont partout, ce qui explique que les plongées parmi les requins sont sans danger. En fait, il se concentrent dans la partie centrale de la passe où il existe un fort courant entrant ou sortant. On les observe depuis les bords, accrochés à du corail pour stationner et les regarder. De plus, ils ne chassent que la nuit. Il n’y a jamais eu d’accident.
C’est donc l’esprit serein et les yeux grands ouverts que le capitaine se joindra à une palanquée de cinq plongeurs pour une plongée dérivante - il suffit de se laisser porter par le courant - dans cet aquarium XXL à accrocher absolument au palmarès de tout plongeur passionné.
La première partie, avec une longue langue de sable très blanc, fait penser à une piste de ski.
Puis la passe devient plus profonde et nous bifurquons sur le côté au milieu des patates de corail pour s’arrêter devant deux rassemblements de squales appelées « murs de requins ».
Le courant étant rentrant, on voit bien ceux allant de droite à gauche et qui restent quasiment immobiles tandis que ceux qui font la route inverse avancent beaucoup plus vite.
La plongée durera une heure. Elle se terminera directement sous le ponton du club de plongée où attendent Sylvie et Jessica qui ont pratiqué du snorkeling pendant ce temps.
Certes, les requins pointe noire sont plus petits, mais cela impressionne quand même.
Deux gros napoléons résidents - quasiment domestiqués - se promènent dans les parages avec leur allure débonnaire, leur grande bouche aux lèvres pulpeuses et leur bosse sur le front faisant penser au chapeau de l’empereur. Ils se prénomment Jojo et Josette, ça ne s’invente pas…
Nous passons notre dernière soirée aux Tuamotu avant d’entreprendre l’ultime étape de notre grande boucle jusqu’à Tahiti.
Le ciel chargé de nuages et le soleil couchant nous gratifie d’un spectacle flamboyant qu’on ne voit qu’au bord de la mer.

Après une période de calme nous clouant sur Fakarava, les vents favorables et assez forts sont enfin revenus pour nous porter vers l’ouest. Les derniers fichiers de prévision météo sont chargés sur la tablette.
Cela n’empêche pas de tracer sa route « à l’ancienne » avec la carte papier, le compas pointe sèche et la règle Cras. Mais ce n’est qu’un simple exercice intellectuel, car les moyens modernes assistés du GPS sont infaillibles et sont devenus indispensables.
Il reste toujours la boussole et la carte en l’absence de toute énergie, ce qui peut toujours arriver si le bateau prend la foudre en pleine mer comme ce fut le cas récemment pour nos amis Anne et Philippe, sur leur catamaran et sur ce même trajet.

Jessica aura été de toutes les étapes de notre épopée marquisienne, exceptés les 3 jours où elle a déserté Jo&Jo pour une randonnée et un camping avec quatre autres jeunes équipiers de bateaux en transit sur Nuku Hiva.
Notre cohabitation s’est idéalement bien passée durant le séjour dans ce milieu exigu, au point que nous l’avons très vite considérée comme notre propre fille. Elle est d’ailleurs plus jeune que nos deux Jonathan… Elle est devenue, comme on dit en Polynésie, notre fille fa’a’amu.
Car s’il y a bien une autre particularité des mœurs polynésiennes incompréhensibles aux européens, c’est bien cette tradition et cette relation entre parents et enfants fa’a’amu.
Le faʼaʼamuraʼa désigne les pratiques traditionnelles d’adoption ouverte - inconnue en droit français - permettant de confier et de donner son enfant. Elles sont extrêmement répandues dans toute la société polynésienne. Et ce, de la manière la plus simple et la plus naturelle qui soit.

Il arrive même qu’un couple promette de donner à un autre couple un enfant qui n’est pas encore né, sans qu’on puisse véritablement parler de mère porteuse ou de GPA (Gestation Pour Autrui) au sens où on l’entend en Europe.
Il n’y a pas d’anonymat et tout se fait au vu de la société. L’alliance ainsi nouée entre les deux familles est extrêmement étroite et possède la même fonction sociologique que le mariage.
Différentes études anthropologiques de 1960 à 1990 montrent la présence d’enfants faʼaʼamu à des taux compris entre 40 % et 80 % des maisonnées touchées dans certains territoires, avec une moyenne comprise entre 20 % et 40 % sur l’ensemble du pays.
Aux Marquises en particulier, deux pratiques anciennes évoquent l’adoption : l’échange de nom et l’adoption d’enfant.
L’échange de nom se pratique avec une autre personne du même sexe. Cette pratique n’a lieu qu’entre personnes du même rang et la refuser est une insulte. Elle donnait jadis à celui qui en était l’objet tous les droits de la personne qui y avait consenti, même sur sa femme. Les deux personnes entraient mutuellement dans la famille et dans la parenté de l’autre, au même rang : le père de l’une devenant aussi père de l’autre. Au passage, cette pratique de changement de nom nous est bien entendu vivement déconseillée, car on imagine aisément que « Jessica Jault » soit particulièrement dur à porter, quel que soit le poids des cageots…
L’adoption faisait véritablement entrer l’enfant dans la filiation de ses parents adoptifs. Dans les temps anciens, les droits de l’enfant adoptif étaient considérables surtout si ses nouveaux parents étaient un couple princier stérile. L’enfant adopté prenait alors la situation d’un premier-né.
S’il y a des adoptions volontaires comme dans chaque pays, les adoptions prescrites sont quant à elles exclusivement intrafamiliales et se justifient pour des raisons de force majeure : séparation du ménage, maladie, mort. Elles sont considérées comme obligatoires et elles évitent de fait les abandons d’enfant ou des placements dans des centres sociaux.
L’ensemble des jeunes membres de la fratrie - frères et sœurs du même lit et de leurs descendants sur une, deux, trois générations - sont alors susceptibles d’être adoptés, généralement par les parents du conjoint originaire du lieu où il réside.
Le faʼaʼamu intrafamilial reste le plus courant, suivant une coutume d’adopter les premiers petits-enfants par les grands-parents. Elle occupe un statut à part qui repose sur la conviction profonde de l’existence d’un lien solide entre générations alternées.
Les petits-enfants sont souvent l’objet de la sollicitude de leurs grands-parents qui peuvent les réclamer auprès des parents de naissance.
L’aspect positif du faʼaʼamuraʼa est l’expression de la solidarité familiale et communautaire. Elle permet à certains enfants de se sentir désirés, objets de projet et d’investissement, lorsque les parents de naissance n’ont pas manifesté ce désir à leur égard.
Pour les aspects négatifs, les enfants faʼaʼamu se retrouvent hélas en forte proportion dans la délinquance juvénile, à la suite d’adoptions ratées sans projet ni réel désir - l’enfant étant repris au bout d’un certain temps par ses premiers parents, ou menacé de l’être - et sans encadrement juridique. Les conséquences pour l’enfant sont le développement d’un sentiment d’angoisse, d’exclusion, d’incertitude, et un grand manque affectif.

L’assemblée de la Polynésie française a reconnu un statut aux enfants faʼaʼamu en les assimilant aux ayants droit en ligne directe pour les donations et les donations-partages mais l’arsenal juridique utilisé en Polynésie n’est que partiellement adapté aux pratiques vécues, beaucoup de situations de faʼaʼamu ne sont pas même formalisées juridiquement.
Cette grande liberté et ce relatif vide juridique ont été la source d’abus par des métropolitains par le passé. Cela s’est caractérisé par une prospection intensive pour obtenir des enfants à adopter, accompagnée de pressions sur la famille polynésienne - surtout la mère - pour qu’elle consente à l’adoption et la rupture du lien avec la famille biologique après le départ de l’enfant.
C’est bien entendu contraire à l’essence même du fa’a’amu qui intègre la notion communautaire et familiale élargie.
Nous en avons rencontré un peu partout dans des familles que nous avons eu la chance de côtoyer ou de connaître, avec des enfants parfaitement intégrés et heureux, dont les parents biologiques vivaient sur d’autres îles ou archipels.
On est bien loin du cadre normalisé et moralisateur de la cellule familiale judéo-chrétienne et du slogan étriqué « un papa et une maman » de certains intégristes, censé garantir le bien-être et le développement de l’enfant par cette seule injonction.
La notion même « d’enfant naturel » ne veut plus dire grand-chose dans ce contexte et on ressent plus largement cet esprit de partage, d’accueil, de générosité dans l’essence même de chaque polynésien.
Après un peu moins de 48 heures de navigation au portant toutes voiles déployées jusqu’à Papeete, nous arrivons enfin au terme de notre boucle Tahiti-Tuamotu-Marquises.
Partis l’année précédente, le 21 décembre 2020, nous revenons au point de départ le 15 mars 2021, après plus de 2400 miles, soit 4500 kilomètres parcourus en près de 3 mois. Cela aura représenté près de 600 heures de navigation cumulée, soit 25 jours à passer d’île en île dans la journée ou d’entreprendre de plus longues traversées de plusieurs jours.

Pas d’avarie majeure à déplorer, juste la maintenance ordinaire de petites choses qui cèdent sous l’usure du temps et l’agression du milieu marin.
Seul le génois un peu fatigué a été déchiré à l’aller dans un grain soudain à plus de 35 nœuds et a été réparé à Fakarava. Le guindeau a donné des signes récurrents de faiblesse malgré des réparations de fortune et il nécessitera une révision complète à l’arrivée au port. La dernière levée d’ancre s’est faite très sportivement à la force des bras dans le lagon de Fakarava, avec plus de 30 mètres de chaîne à remonter.
Nous arrivons à Papeete le matin au lever du soleil et l’île de Tahiti est exceptionnellement exempte de nuages et nous montre son joyau, le diadème de montagnes qui apparait au fond de la vallée de Arue.

Il est temps de quitter notre équipière, de fermer sa parenthèse de navigation et de la rendre à sa vie terrestre au cœur de Papeete, non sans lui avoir demandé de laisser un message et de signer notre livre d’or.
A Jo&Jo,
A mes parents fa’a’amu,
Au capitaine et sa sirène,
3 mois à la découverte de la Terre de hommes (et quels hommes !) et des lagons turquoise des Tuamotu.
3 mois à la découverte de la navigation dans les mers du sud.
3 mois de partages, d’apprentissages, de rires, de petites galères, de rencontres, de contrepétries, de parties de « 6 qui prend » endiablées, de soirées cinéma, de musiques locales, de lectures, d’écriture, de farniente, d’apéros et de cahuètes !
A l’heure où j’écris ces lignes, je pense déjà dire que cette épopée fait partie de mes plus beaux souvenirs de voyage. Des souvenirs gravés jusque dans la peau.
Mauruuru Sylvie pour tes bons petits plats, ton sourire et ta gentillesse.
Mauruuru Jacky pour ton savoir et ton humour.
Mauruuru roa pour cette expérience unique au bout du monde dont j’ai la chance de faire partie.
Du coup, quand on y pense, il faut reconnaître que c’était ouf, n’est-ce pas ?
Je vous embrasse
Jessica





















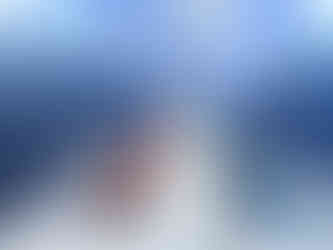










































Commentaires