36 - Raroia et Hiva Oa
- Jo et Jo

- 23 janv. 2021
- 22 min de lecture

Nous voici à Raroia après une courte traversée de 20 heures à peine pour couvrir les 80 miles (150 kilomètres) depuis Makemo. Une grande partie à la voile et la fin du parcours de nuit sous un ciel étoilé sans aucune pollution lumineuse mais avec le vent de face pour gagner toujours plus vers l’est avant de rejoindre les Marquises. Un temps calculé au mieux pour franchir la seule passe d’entrée au petit matin, avec un courant acceptable pour entrer en toute sécurité.
Nous étions le dernier bateau à quitter Makemo - nos amis américains du catamaran SeaRose ayant levé l’ancre 3 heures avant nous - nous avons navigué sans voir un seul bateau et nous sommes à nouveau seuls à nous amarrer au quai du village principal de Ngarumaova. En ces temps de pandémie, les voyages entre les pays sont drastiquement réduits par la force des choses et par les quarantaines mises en place à la petite semaine sans réelle stratégie d’un endroit de la planète à l’autre.

Et puis, l’archipel des Tuamotu est le plus vaste des 5 archipels mais représente seulement 6 % de la population de la Polynésie. Nous venons de parcourir les trois plus grands atolls et fait est de constater que nous n’avons pas vu grand monde.
En fait, Raroia est très petite et seulement 50 personnes y vivent en permanence à l’année, 200 en comptant les enfants mais ils sont scolarisés dans l’île de Makemo et ne rentrent que pour les vacances scolaires.
C’est le cas de Victorine, une charmante gamine de 10 ans qui vient jouer sur le quai devant Jo&Jo. Elle est en CM2 à Raroia. Une de ses sœurs est au collège à Makemo et l’autre au lycée à Papeete. Son grand frère quant à lui est militaire en France. Un exemple typique de ces familles polynésiennes éclatées dont le cercle est élargi par la dissémination des infrastructures scolaires sur le territoire.
Victorine avait déjà « tapé dans l’œil » de Myriam et Alain, les précédents propriétaires du catamaran, qui avaient écrit dans leur blog en novembre 2018 : « Victorine, un petit soleil qui vit dans une baraque dont la seule fenêtre donne sur une vue paradisiaque sur le lagon. Elle accueille les voiliers et vit avec un sourire que j’aimerais voir sur le visage de tous les enfants qui ont une belle maison ».


Deux ans plus tard, Victorine est toujours au rendez-vous avec son sourire et sa candeur. Elle ne nous quitte pas et se sent flattée d’avoir été reconnue.
Les enfants de cette petite île n’ont pas beaucoup de distractions et passent l’essentiel de leur temps à nager.
Le quai est le centre de la vie de ces jeunes qui viennent passer la soirée à grands renforts de « boom-box ».

Il y a un point d’eau gratuit au cœur du village et un habitant nous prête très gentiment son tricycle pour quelques allers-retours de jerricans et de seaux afin de remplir les cuves de Jo&Jo.
C’est l’occasion de tester ce mode de locomotion si courant aux Tuamotu, qui nécessite un vrai apprentissage, surtout dans les virages.
Comme annoncé en teasing à la fin de notre précédent blog, Raroia est connue avant tout pour être « l’île du Kon Tiki ». Nous profitons de la traversée pour visionner le film tourné en 2012 et qui relate cette folle expédition.
Thor Heyerdal, le porteur du projet Kon Tiki est un anthropologue danois, à la fois dandy et scientifique, qui avait obtenu un financement en 1937 pour explorer la Polynésie avec son épouse. Ils s’établirent à Fatu Hiva, l’île la plus au sud de l’archipel des Marquises.
En discutant avec un vieil indigène de Fatu Hiva, il lui demande d’où viennent ses ancêtres, convaincu dans un premier temps par la théorie largement partagée par la communauté scientifique que les migrations polynésiennes viennent de l’ouest.
Pourtant cet autochtone, contre toute attente, lui affirme que ses ancêtres ont suivi Tiki, le dieu soleil qui serait arrivé par la mer avec sa tribu pour peupler ces îles alors désertes. Il venait de l'est, d'un grand pays très lointain. La légende n'en dit pas plus.
Thor est séduit par cette révélation et appuie son argumentaire par le fait que le soleil se lève à l’est, que les vents et les courants dominants dans l’océan pacifique vont d’est en ouest - nous sommes bien placés pour le savoir à avancer contre le vent depuis 15 jours - et que s’ils ne possédaient pas de bateaux dignes de ce nom, ils se déplaçaient en radeaux de bois et de balsa. De plus, une variété d’ananas de Polynésie aurait des origines sud-américaines.
Aveuglé par cette théorie révolutionnaire de l’exploration du Pacifique par les Incas et convaincu qu’il entrerait dans l’Histoire au même titre que Charles Darwin après sa découverte des Galapagos à l’origine de la théorie sur l’évolution, le scandinave n’aura de cesse de vouloir en prouver le bien-fondé.
Thor mettra 10 ans à élaborer sa thèse et la présentera à de nombreux comités scientifiques américains qui tous la rejetteront sèchement, car elle s’inscrit contre toutes les idées reçues.
C’est alors qu’il tenta de prouver sa théorie en entreprenant lui-même la construction du radeau en matériaux traditionnels, sans autre apport qu’une radio qui rendra l’âme assez rapidement.
Accompagné de 5 hommes - norvégiens et suédois - aussi aventureux que lui, ils partirent du port de Lima au Pérou et se laissèrent dériver par le courant sud-américain El Niño jusqu’au sud des îles Galapagos, puis par les alizés d’est qui les firent s’échouer sur la barrière de corail de l’île de Raroia, 8000 kilomètres et 101 jours plus tard.
Un petit tableau du radeau Kon Tiki trône dans la salle de réunion de la nouvelle Mairie, qui sert également de zone de survie en cas de cyclones ou de tsunamis.

Le radeau grandeur nature est par ailleurs visible au musée du Kon Tiki à Oslo.
Cette épopée a fait l’objet d’un livre traduit en 70 langues et vendu à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde.
Le documentaire tourné lors de l’expédition a reçu un oscar.
Pour autant, la démonstration pratique de la théorie échafaudée par Thor Heyerdal n’en fut hélas pas une malgré la réussite de l’aventure.
L’exploit ne reste - excusez du peu - qu’au rang de l’aventure humaine, à la limite de l’impossible et d’une forte dose de croyance en ce « Tiki » dont l’image ornait la voile du radeau et protégeait ses occupants de son « mana » (esprit).
Et dire que Thor ne savait même pas nager…
Toute la communauté scientifique s’accorde aujourd’hui sur l’origine des migrations polynésiennes, via l’archéologie et les poteries « Lapita » provenant des Fidji et Samoa à l’ouest.
En voici une synthèse :
Ce qui est incontestable, souligne l’archéologue Patrick V. Kirch, c’est que la colonisation s’est faite d’Ouest en Est : Le cadre général en termes de temps et d’espace, concernant la dispersion des Polynésiens, depuis le foyer situé aux Fidji et en Polynésie occidentale, est relativement bien établi, grâce aux fouilles stratigraphiques réalisées durant trois décennies. De ce fait, la théorie controversée du peuplement d’Est en Ouest de Thor Heyerdahl est définitivement rejetée. Les dates d’occupation humaine les plus anciennes se trouvent aux Fidji, ensuite en Polynésie occidentale, et les plus récentes, en Polynésie orientale. Ce qui signifie que le peuplement des îles polynésiennes s’est fait contre les vents et les courants dominants, à l’intérieur des limites de la zone intertropicale où se situent toutes les îles polynésiennes, exceptées celles des sommets de son triangle, l’île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande.

Cette île de Raroia est charmante mais ce n’est hélas qu’une étape et nous ne pouvons rester plus longtemps sans perdre de vue notre objectif des Marquises.
Nous attendons les vents favorables. La météo est capricieuse et le vent se lève vers 4 heures du matin, accompagnant un grain orageux pour secouer notre catamaran en bord de quai.
Il nous faut pourtant combiner le vent, les précipitations annoncées et la marée pour franchir la seule passe dans le courant sortant.
Le marnage est d’environ 30 centimètres, mais ce qui compte est le sens et l’intensité du courant, qui peut être assez fort et empêcher de manœuvrer en sécurité, voire interdire toute entrée ou sortie au pic de l’amplitude.


Un dernier point à la poste du village pour la mise à jour de nos fichiers météo et prendre connaissance des dernières nouvelles et nous appareillons vers les mythiques Marquises, à plus de 400 miles (750 kilomètres en route directe).
Bien entendu, ce sera forcément plus long car cela ne se fait pas tout droit et il faudra compter avec les sautes du vent, la houle d’une mer agitée et surtout une direction au plus près - face au vent - pour atteindre Fatu Hiva à la voile sans l’aide des moteurs.
Notre logiciel d’estimation de route en fonction de la météo nous annonce une arrivée sous 3 jours, ce qui est exceptionnel. Il est d’usage dans le monde des marins de compter une distance raisonnable de 100 nautiques ou 100 miles (185 kilomètres) par 24 heures, soit une moyenne de 4 nœuds à l’heure.
Une estimation de 4 jours et 4 nuits nous semble plus réaliste.
Mais, de grains violents et de face à 27 nœuds en début de parcours jusqu’à des périodes de « pétole » avec des vents à 4 nœuds, avec en prime un vent tournant et notre volonté de préserver notre capacité de gasoil mise à mal depuis Fakarava, notre périple durera finalement… 6 jours et 5 nuits !
Tout ce temps sans voir âme qui vive ou la moindre terre, mais des oiseaux - sternes, frégates - nous accompagneront de temps en temps, nous interrogeant sur leur capacité à voler si loin de la terre.
Nos seuls passagers clandestins seront des poissons volants de toutes tailles venant s’échouer sur Jo&Jo durant la nuit.
Notre objectif de Fatu Hiva se heurte à la réalité des vents et de notre autonomie des moteurs. Par sécurité, nous bifurquons plus au nord vers les îles de Tahuata et de Hiva Oa, plus accessibles.
Au petit matin du 6ème jour, l’ile de Tahuata se dessine à l’horizon.
Elle fut la première découverte en 1595 par l’espagnol Alvaro Mendana de Neyra.
Las Islas Marquesas furent ainsi nommées en l’honneur de la marquise de Mendoza, épouse du vice-roi du Pérou qui avait favorisé son expédition, qui recherchait à l’origine de l’or et des pierres précieuses sur des terres à l’ouest de l’Amérique latine.

C’est alors qu’une cohorte de dauphins à long bec vient à notre rencontre et nous escorte pendant près de 30 minutes.
Nous avons l’impression d’être à bord d’un véhicule protocolaire devancé et encadré par la garde nationale équestre ou motocycliste, dans la grande tradition républicaine.
Un moment inoubliable et émouvant, que nous vous faisons partager dans le film ci-dessous, sur la musique épique et puissante de Vangelis « Conquest of Paradise », qui a servi de bande-son au film « 1492 » sur la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.
Nous avons eu aussi ce sentiment - toutes proportions gardées - de découvrir cette terre tant attendue se rapprocher et signer la fin de notre traversée sur un océan où nous n’avons une nouvelle fois rencontré personne.

Nous passerons devant l’ïle de Tahuata, aux falaises à pic et hostiles sur ses faces au sud et à l’est.
Nous y reviendrons plus tard car elle fait partie de notre programme.
Nous arrivons à Hiva Oa, l’île qui abrita les dernières années de la vie de Paul Gauguin et de Jacques Brel.
Il est 17h00 et il fait plus sombre qu’à l’accoutumée. Tout ce trajet depuis Papeete en suivant la route du nord-est nous a pratiquement fait changer de fuseau horaire. Les Marquises comptent une demi-heure de moins et nous ne sommes plus qu’à 10h30 de décalage avec la métropole.
Ici, pas de lagon pour effectuer un mouillage au calme derrière une barrière de corail. Les montagnes à pic - anciens volcans dont la base se trouve 4000 mètres au-dessous du niveau de l’eau - se jettent directement dans la mer en y créant des anses, des baies, des caps.
Il n’est de solution que les baies bien abritées du vent dominant mais la houle qui y pénètre rend le stationnement dansant, surtout au fond où le ressac vient ajouter les vagues de reflux à celles venant du large. Certes, le flux et le reflux, ça fait marée, mais il convient d’être vigilant et de dérouler suffisamment de longueur de chaîne pour éviter tout décrochage et pas trop pour éviter les bateaux voisins quand le vent tourne. Surtout que le vent peut amplifier le phénomène par l’effet venturi en dévalant des vallées montagneuses…

Notre mouillage de Tahauku, port principal du village d’Atuona est le refuge des voiliers de passage. C’est aussi le port d’arrivée du paquebot-cargo mixte Aranui qui passe toutes les 3 semaines et des goélettes qui viennent apporter les vivres et le matériel de Tahiti une fois par semaine.
Lors du confinement au printemps 2020, la baie, pourtant petite, était saturée de voiliers et c’était un véritable capharnaüm où chacun devait être amarré à l’avant et à l’arrière pour éviter les collisions lors des changements de vent sous une houle formée.
Une sorte de « cuvette pleine de bouillons », contrepétrie que chacun comprendra…
Un artiste Jill Schinas, du voilier Mollymawck, a illustré de manière cocasse la situation en « baie de quarantaine », comme il a surnommé la baie de Tahauku, où plus de trente équipages de voiliers ont été confinés à bord.
Pour mémoire, Jo&Jo se trouve au mouillage hors de la baie, devant la digue au premier plan, à l’endroit où est figuré un catamaran avec deux chiens blancs à bord
Ce même jour de notre arrivée, le 14 janvier, à l’autre bout de planète à Barcelone, naissait Emilia, la petite-fille de Jonathan et Cristina, après neuf mois de confinement dans le ventre de maman.
Grande joie pour les nouveaux parents devant leur premier enfant qu’ils appellent leur petite princesse.
Pour nous, grande joie également, mais ce sera notre petite marquise, allez savoir pourquoi…
Nous voici donc dans ces célèbres Marquises dont chaque navigateur, chaque touriste nous parle avec émotion.

L’archipel des Marquises se mérite parait-il - nous en savons quelque chose après 6 jours et 5 nuits - et cela doit très certainement ajouter à la magie du lieu.
Il faut dire que c’est le seul endroit de la planète qui soit aussi éloigné d’un continent, que ce soient les Amériques nord et sud, l’Asie ou l’Océanie.

L’auteure Eve Sivadjian dans son ouvrage « Les îles Marquises, archipel de mémoire » en parle en ces termes :
« De Herman Melville à Jacques Brel, en passant par Paul Gauguin, Robert Stevenson, Jack London, Alain Gerbault et Roger Carpriaux, tous ont été subjugués par les Marquises.
Aucune partie du monde n’exerce un attrait aussi puissant sur le visiteur que le « Fenua Enana » (la Terre des Hommes). De ces îles austères et mystérieuses, terres les plus éloignées de tout continent, peuplées il y a près de 25 siècles par de légendaires navigateurs maoris, on revient différent. »
Pillées au début du XIXème siècle par des forestiers pour le bois de santal et par des baleiniers américains venant pêcher au large, le plus grand dommage a pourtant été sanitaire puisque ces hommes apportèrent les maux de la civilisation avec la variole, la syphilis, la tuberculose ainsi que des insectes comme les tristement célèbres « nonos », des moucherons minuscules à la morsure insupportable qui infestent les îles.

Devant ce pillage et ces ravages, le roi marquisien Iotete demande en 1842 la protection de la France contre les navires américains.
La protection se transformera en prise de possession pure et simple avec un blocus de l’amiral Dupetit-Thouars pour isoler Tahuata de Hiva Oa avec son navire « Le Bordelais » dont le nom subsiste aujourd’hui pour nommer le chenal entre les deux îles.
Cette mainmise de la France s’est accompagnée d’une évangélisation implacable qui fit faillit anéantir la culture marquisienne.
Choc des cultures comme on peut le remarquer sur les images du roi et de l’amiral, tant dans le décorum que dans la tenue d’apparat, même si chacun d’entre eux peut dire « j’ai des rebords à mes épaulettes » (ma contrepétrie favorite, il suffit d’échanger le b et le m) …
Ce protectorat n’arrêta pas les ravages sanitaires et faillit bien décimer la population, passant de 20.000 marquisiens en 1842 à moins de 2000 un siècle plus tard. Mais la civilisation avait gagné, les sauvages nus et tatoués étaient devenus bien habillés, bien pratiquants et bien dociles.
Toutes traces de religion, de coutumes, d’identité même ont été systématiquement effacées pour en arriver là. Tout était interdit : les tatouages, le port du paréo, se baigner nu, les chants, les danses, les fêtes traditionnelles. Les lieux de culte - les marae - ont été saccagés. Les tikis, les statues traditionnelles en pierre ont été fracassées pour la plupart ou vendues à l’étranger.
Un véritable génocide humanitaire et culturel sous couvert du rayonnement de la parole d’un Dieu unique et blanc et d’un mode vie européen aux antipodes - c’est le cas de le dire - de l’essence même de la nature du polynésien.
Les blancs - les popa’a - avaient pris le pouvoir et les autochtones, sans être véritablement des esclaves, étaient considérés comme une évidence de race inférieure.
C’est ainsi que Paul Gauguin vint à Hiva Oa en 1901, pour y peindre jusqu'à sa mort en 1903 plus de vingt chefs d’œuvre. Il vivait hors de la communauté blanche, profitait des plaisirs avec les jeunes marquisiennes et partageait sa vie avec une jeune fille de 14 ans qu’il avait fait quitter l’école missionnaire. Son talent n’était pas reconnu à l’époque et il était surtout considéré comme un marginal, un asocial, un mécréant révolutionnaire infréquentable. Par bravade, notamment envers les autorités ecclésiastiques, il avait appelé son atelier « la Maison du Jouir ».
Dans les temps anciens où la civilisation n’avait pas encore imposé ses lois et où l’on n’avait même pas l’idée de planning familial, les filles en âge de procréer étaient naturellement mères très jeunes et la venue d’un être étranger dans la communauté était une bénédiction pour renouveler le sang et limiter la consanguinité. Encore aujourd’hui, dans les petites îles où ne vivent qu’une poignée d’habitants, ce problème reste vivace. Nombre de jeunes hommes nous ont dit connaître toutes les filles de leur entourage, qui étaient de surcroit leurs cousines.
A regarder et juger les agissements de Paul Gauguin au prisme de notre morale contemporaine, on ne peut que condamner sa conduite, pourtant acceptée des indigènes il y a 120 ans.
De nos jours, il serait poursuivi et condamné pour pédophilie. D’ailleurs, certains « père-la pudeur », ligues de vertu et intégristes de tous poils militent actuellement pour faire enlever ses œuvres du National Museum de New York pour ce seul motif, qui n’a rien de pictural et de culturel.
Imbriquer l’artiste et son œuvre au point de les accepter ou de les rejeter en bloc et sans nuances, est bien d’actualité quand on voit la polémique récente relative à Roman Polanski à la sortie de son film « J’accuse » sur l’affaire Dreyfus que certaines salles ont boycotté en raison des mœurs du réalisateur (on n’ose imaginer en plus des relents d’antisémitisme). Pareils amalgames courent également sur Charlie Chaplin, Woody Allen…
Une anecdote montre bien l’esprit étriqué et mesquin digne du village de Clochemerle de la part des contemporains blancs de Gauguin sur Hiva Oa, qui n’avaient de cesse de le harceler. Le gendarme Charpillet qui représentait l’ordre républicain sur l’île le verbalisa pour défaut de lanterne à son véhicule hippomobile... qui était le seul de l’île !

L’espace Gauguin reproduit aujourd’hui la Maison du Jouir sous un nom plus sage et consensuel.
Il s’agit d’un musée mais toutes les œuvres exposées sont des reproductions. Il y a plus d’une centaine de peintures, sculptures de « Koké », le nom qu’on lui donnait aux Marquises.
L’artiste maudit est aujourd’hui reconnu et il n’est de visiteur à Hiva Oa qui ne se rende dans le vieux cimetière qui domine la ville pour visiter la tombe du peintre.
A gauche de sa stèle se dresse une statue « Oviri » (le sauvage) qu’il avait voulu faire figurer sur sa tombe. Il s’agit en réalité d’une réplique en bronze, l’original étant visible au Musée d’Orsay.
Le centre culturel est en fait un musée dont la particularité est que toutes les œuvres exposées sont des reproductions. Il y a plus d’une centaine de peintures, sculptures de « Koké », le nom qu’on lui donnait aux Marquises. L’œuvre est d’une richesse incomparable. On y voit ses influences bretonnes et polynésiennes, l’artiste se partageant entre ses deux patries de cœur.


« Je voulais à cette époque tout oser, libérer en quelque sorte la nouvelle génération puis travailler pour acquérir un peu de talent. La première partie de mon programme a porté ses fruits, aujourd’hui vous pouvez tout oser, et qui plus est personne ne s’en étonne ».

Ainsi, bien avant Picasso, il peignait non ce qu’il voyait mais ce qu’il ressentait et on lui a souvent reproché ses plages roses, ses arbres bleus ou ses chiens rouges. En témoigne l’exemple du cheval blanc qui est vert.
Un pharmacien de Papeete, déçu lors de la réception du tableau « Cheval blanc » commandé à Gauguin en 1898, l’a refusé. Grande déception de ses descendants !
Mais qui, à cette époque, a pu imaginer un instant que Gauguin avait raison ?
En fait, selon lui, la couleur blanche « comme neige » n’existe pas naturellement en Océanie où tout est verdâtre ou jaunâtre. D’ailleurs, le colorant utilisé par les indigènes, provenant de l’écorce d’un arbre, donne toujours ce ton naturel.
Cette couleur « d’un blanc sale » est très douce, plus intense, plus éclatante et plus chaude que sa cousine froide devenue trop artificielle dans ce milieu tropical où presque tout est vert. Comme ce cheval blanc buvant de l’eau de la rivière à l’ombre des arbres sur un fond de végétation verte. C’est tout naturellement qu’il parait aussi « vert » malgré la blancheur naturelle de sa robe.

Notre halte à Hiva Oa nous a permis de refaire le plein d’eau et de gasoil. Ce sont des denrées rares sur un bateau. Une noria de jerricans avec l’annexe du bateau vers le quai permettra de remplir les cuves.
Nous prendrons nos quartiers devant un bric-à-brac de petit bricolage portatif, au bord des pompes, pour y installer notre bureau connecté WiFi.
La station de carburant peut ainsi se vanter d’avoir deux nouvelles recrues d’essence…
La station est dans le port, mais il n’y a pas de pompe au bord du débarcadère qui est pourtant aménagé pour faire accoster le paquebot Aranui et ses passagers ou les marchandises de la goélette.
Le propriétaire de la station a fait une demande officielle en… 2013 ! Mais ici, pour ce sujet comme pour tous les autres, tout se décide à Tahiti par des ronds-de-cuir souvent incompétents - mais qui appartiennent à la famille du chef ou de l’élu, le népotisme est une valeur universellement partagée dans le monde - qui n’ont que faire de la vie dans îles les plus reculées de leur nombril.

Nous croisons sur la route du village un couple de français de Nantes, Christine et Michel, qui ont mis leur catamaran en cale sèche sur le chantier naval il y a 18 mois.
La crise de la Covid est passée par là et a contrarié leurs projets.
Ils viennent passer 3 semaines pour effectuer quelques réparations sur leur bateau avant de revenir naviguer au printemps.
Nous sympathisons, nous échangeons des informations et nous passerons une soirée au restaurant de leur pension.
Le village d’Atuona s’étale au fond d’une baie de sable noir et s’échelonne le long de la montagne abrupte. La montée est raide et sportive mais la vue y est magnifique, plongeant le regard vers l’infini des eaux profondes de l’océan Pacifique.

Le centre culturel et artisanal offre de belles réalisations de tikis, en pierre ou en bois, dont certains sont clairement d’inspiration pascuane, notamment un moaï coiffé, symbole de l’île de Pâques.
Robert-Louis Stevenson - l’auteur de l’île aux Trésors - écrivit après y avoir débarqué en 1888 à Hiva Oa : « Je pensais que c’était l’île la plus jolie et de loin l’endroit le plus inquiétant du monde ». De fait, elle possède à la fois une beauté sauvage qui suscite l’admiration par temps calme et un aspect sombre et tourmenté par temps orageux qui ne manque pas d’éveiller un certain sentiment d’inquiétude.
Son relief est uniformément déchiqueté, en particulier le long de l’océan, lequel plonge très vite jusqu’à 4000 mètres, ce qui explique qu’à Hiva Oa on n’atterrisse pas au niveau de la mer mais sur une crête, au-dessus d’Atuona.
Cet endroit est improbable, avec sa piste bombée qui épouse le relief de la montagne, si courte qu’un avion ATR 42 est le plus gros qui puisse y atterrir, souvent au prix de quelques frayeurs. C’est de là que partait Jacques Brel et son « Jojo » pour acheminer courrier, marchandises et personnes malades sur Nuku Hiva ou Tahiti, par tous temps. Le petit aéroport a été baptisé à son nom.
Jacques Brel se retira en 1975 dans cette « île au large de l’espoir » pour échapper au bruit et à la fureur de notre société . Il y écrira « Les Marquises » évidemment, mais aussi « Orly », « Jaurès » et « Jojo ». Contrairement à Paul Gauguin, il n’a en rien heurté la communauté locale, bien au contraire, car il s’est dévoué pour elle.

Venu de France avec un voilier, l’Askoy, pour effectuer un tour du monde avec sa compagne Madly Bamy et sa fille France, qu’il débarquera aux Antilles pour cause d’incompatibilité d’humeur dans cet espace restreint, il arrivera éreinté aux Marquises. Il venait de se faire enlever la moitié des poumons l’année précédente et son lourd voilier était difficile à manœuvrer.
Parfaitement inconnu à Hiva Oa pour son plus grand plaisir - et il le restera, les autochtones n’apprenant qu’après sa mort qu’il était une vedette internationale de la chanson et du cinéma - il y trouvera le repos qu’il y était venu chercher.
Il avait rencontré sa compagne Maddly Bamy sur le tournage du film « l’Aventure c’est l’aventure » de Claude Lelouch en 1971, où elle jouait un petit rôle.
Lui jouait aux côtés de Lino Ventura, Charles Gérard, Charles Denner et Aldo Maccione. On se souvient tous de la démarche de drague enseignée par Aldo « la classe » sur la plage…
On se souvient aussi que dans son dernier film « l’emmerdeur » avec son ami Lino Ventura, il jouait le tout premier « François Pignon » de la longue série incarnée par la suite par Pierre Richard ou Jacques Villeret.
Maddly était actrice et a notamment joué un petit rôle dans « La piscine », avec Alain Delon et Mireille Darc. Elle a, à l'époque, une liaison avec Alain Delon, qui partage sa vie entre elle et Mireille Darc. Le téléfilm Madly (follement), scénarisé par Mireille Darc, avec Alain Delon et Mireille en vedettes, est inspiré de cette relation à trois avec une antillaise.
Mais elle était surtout connue comme danseuse pour avoir fait partie de la troupe des « Claudettes ». Difficile d’imaginer que l’une des filles black et longilignes en mini-short et chaussures plateformes serait la compagne de l’austère Jacques Brel. Elle devint également écrivain.
L’"Espace Brel" est dédié davantage à l’homme qu’au chanteur.
C’est l’aviateur au grand cœur qui est honoré ici. Celui qui avait une « place du pauvre » à sa table de gourmet et qui organisait pour le village des séances de cinéma en plein air à l’aide de deux projecteurs.
Grâce à une équipe de bénévoles l’avion de Brel est restauré et placé dans un hangar spécialement construit et aménagé.
Au-delà du pilote altruiste et généreux, le caractère de Jacques Brel est révélé au travers de ses chansons et de ses films. Des extraits de ses textes ou de ses pensées ornent de grands panneaux sur lesquels on peut lire :

« Nous sommes provisoires. Nous sommes éphémères. Rien n’est dû. Cette putain de vie, il faut la vivre. Il faut essayer que ce soit tendre et là, c’est difficile parce que nous ne sommes pas du tout armés ».
« Du fond du Pacifique, je vis sur une île perdue. Belle à crever, mais rude, austère ».
« Qu’est-ce qui m’indigne le plus ? La bêtise. C’est la mauvaise fée du monde. C’est la sorcière du monde. La bêtise, c’est un type qui vit et il se dit : Je vis, je vais bien, ça me suffit. Il ne se botte pas le cul tous les matins en disant : Ce n’est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C’est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur et du cerveau ».
Dans le cimetière, à deux pas de la tombe de Gauguin, celle de Jacques Brel est devenue un lieu incontournable de l’île et s’il n’y a pas de fleurs - il y en a tant tout autour - ce sont des petit cailloux et galets qui tapissent sa tombe de témoignages.
Ce lieu de mémoire et de repos a été pourtant un champ de bataille entre la famille du chanteur et le reste de la communauté.
A l’origine, figurait sur sa tombe son portrait et le visage de Maddly penché sur son épaule. En juillet 1999, France Brel, sa fille, assouvissant certains ressentiments, a fait enlever cette plaque pour la remplacer par deux autres... enlevées à leur tour dès qu’elle eut repris l’avion, par les amis locaux de Jacques, qui ont remis la première à sa place.


Nous apportons notre « grosse pierre » à l’édifice mémorial avec cette simple épitaphe
De Jacky à Jacky
+ Sylvie + Jessica
18-01-21
en souvenir de l’incontournable « chanson de Jacky », celle où il se remémore le temps de sa jeunesse où on l’appelait Jacky.
Il voulait à nouveau « être une heure, une heure seulement, être une heure, une heure, quelquefois, être une heure, rien qu’une heure durant, être beau, beau, beau et con à la fois».
Laissons à l’artiste le soin de parler de sa terre d’adoption avec sa sensibilité et sa précision, dans la dernière chanson de son dernier album, Les Marquises :

Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard Le cœur est voyageur L’avenir est au hasard Et passent des cocotiers Qui écrivent des chants d’amour Que les sœurs d’alentour Ignorent d’ignorer Les pirogues s’en vont Les pirogues s’en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux en font Veux-tu que je dise Gémir n’est pas de mise
Aux Marquises…
Les Marquises, c’est aussi le berceau d’une civilisation très ancienne que son isolement et la rudesse de sa géographie ont réussi à préserver plus qu’ailleurs, malgré les assauts de la civilisation.
Chacune des vallées est riche en sites archéologiques témoins de cette civilisation marquisienne
en grande partie disparue.
A l’est de l’île se trouve le site de Puamau. Ce n’est qu’à 45 kilomètres mais il faut 2 heures de pistes - la plupart aujourd’hui bétonnées ou en voie de l’être - et un indispensable 4x4 pour arpenter les cols vertigineux, les lacets et la route parfois à flanc de ravin.
Il n’y a pas plus sauvage et plus reculé et les paysages sont à couper le souffle. Ces montagnes souvent arrosées par les pluies sont généreuses en végétation et notre parcours est jalonné de chevaux, vaches, chèvres attachés en bord de route ou en liberté.
Le modernisme côtoie le passé. Nous sommes arrêtés par un chantier mobile de bétonnage de la chaussée, à peine quelques minutes après avoir croisé un jeune marquisien rapportant deux grandes perches de bambou sur son cheval.
Les infrastructures sont malgré tout réduites, et l’occultation d’une voie de circulation se fait avec les moyens trouvés sur place, dans une cocasse, mais efficace, interprétation d’une bande discontinue.
La route en bord de ravin offre une vue spectaculaire sur la découpe de la côte qui s’enfonce dans l’océan et qui serpente sur des pentes vertigineuses où l’on peut à peine croiser les rares 4x4 qui s’aventurent par là.
Le site de Tipona, au village de Puamau abrite les plus grands tikis traditionnels des Marquises, de ceux qui n’ont pas été détruits par les évangélisateurs des siècles passés.
Ils ne sont pas en très bon état du fait des outrages du temps.
Le plus grand mesure 2,43 mètres et date du XVIIIème siècle. Parmi la statuaire présente, l’atypique tiki couché sur le ventre est particulièrement remarquable.
Notre route de retour s’attarde au nord de l’île dans le charmant village de Hanaiapa. Il est aussi appelé « le village fleuri ». De nombreux arbustes de couleur bordent la route et la plage est un spot de surf réputé.
Ici, pas de restaurant ou de roulotte.
Nous nous invitons chez Rafi, une femme de 54 ans - mais déjà 12 petits-enfants - faisant à l’occasion table d’hôtes dans sa modeste demeure, mais le mot est largement usurpé.
En fait nous mangerons une portion de frites, un hamburger, accompagnés de deux litres de jus de mangue et une glace à la vanille tahitienne pour l’équivalent de 8 euros par personne.
En plus, nous repartons avec des brassées de fruits offertes par notre hôte : mangues, bananes, pamplemousses, ananas, caramboles, citrons et uru, décrochés de l’arbre par Jessica et Sylvie.
Ici, il n’y a qu’à lever les yeux et cueillir…
Nous finissons la journée par le site de Taaoa, non loin d’Atuona, véritable Machu-Picchu marquisien. C’est le plus grand site archéologique de la Polynésie.
Partiellement restauré, il comporte plus de mille pae-pae (soubassement de pierre des anciennes constructions), un grand tohua (espace pour les diverses manifestations) et plusieurs me’ae (marae ou autel sacré).

On peut encore voir le puits où étaient gardés les prisonniers.
Un peu plus loin, un grand banian sacré, plusieurs fois centenaire, pousse parmi les constructions.
Autrefois, on entreposait les crânes des sacrifiés au pied et parmi les racines de cet arbre gigantesque, le plus grand des ficus au monde.

Autre célébrité à avoir rendu les Marquises célèbres, Maud Fontenoy laissera une empreinte dans la baie de Tahauku en y débarquant le 26 mars 2005 d’un canot de 7,50 mètres sur 1,60 mètres, l’Océor, après un périple de 73 jours et 6780 kilomètres à la rame, reliant le Pérou à la Polynésie.
Elle dédicacera une affiche qui trône en bonne place dans l’hôtel qui domaine la baie où elle séjournera quelque temps avant de reprendre les rames jusqu’à Tahiti.
A 27 ans, elle devenait ainsi la première femme à traverser le Pacifique à la rame, en suivant l’itinéraire du radeau Kon-Tiki de Thor Heyerdahl qui avait réalisé cette même traversée en 1947.
Elle réalisera par la suite le tour du monde complet, de la Réunion à la Réunion.
Cet exploit lui vaudra d'être nommée personnalité de l'année par le Time Magazine en 2005.
Nous avons retrouvé un reportage de France 3 de l’époque sur son arrivée à Hiva Oa.
Nous sommes aux Marquises depuis une semaine et nous en avons pris plein les yeux mais ce n’est pas fini.
Nous ne repartirons au mieux que dimanche pour l’île principale de Nuku Hiva au nord-ouest, portés par les alizés, pour marcher dans les pas de Hermann Melville, navigateur et écrivain (Moby Dick) qui vécut 4 mois au sein d’une tribu Taipi en 1848, les plus farouches guerriers de l’île », réputés anthropophages…


















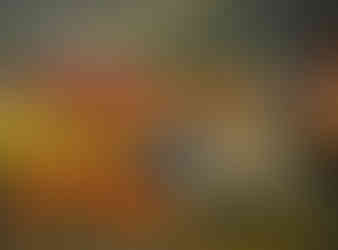














































































Commentaires